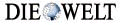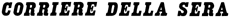|
Le Grand Théâtre se mue en une volière de rêve SYLVIE BONIER "Ah!, j’ai vécu!" Comme conclusion d’un opéra, voilà qui en dit long sur une œuvre apparemment légère. Les dernières paroles proférées par Bonespoir dans Les oiseaux de Walter Braunfels remettent bien en perspective l’approche philosophique et humaniste du compositeur allemand. Sous l’apparente légèreté de sa "comédie lyrique et fantastique", il souligne le sens de la vie, ses nostalgies et ses ivresses lorsque ont été touchés l’esprit, le cœur, et vaincue la soif de pouvoir. On sent que Braunfels a tricoté le livret de ses Oiseaux en même temps que la partition. Le verbe et la note sont si intimement liés qu’ils se répondent, s’illustrent et se révèlent à la perfection. Et c’est avec un naturel renversant que sont conjugués le lyrisme, la verve, les douceurs et la fièvre romantique. La découverte de cette œuvre datant de 1920 et donnée seulement aujourd’hui en création suisse au Grand Théâtre, a émerveillé le public d’ordinaire réservé de la première. La musique, toute en volutes straussiennes et tensions wagnériennes, séduit d’emblée. Le thème, dont la féerie masque à peine le ton plus politique de la pièce d’Aristophane qui inspira Braunfels, secoue les consciences comme les sentiments. Fantaisie fantastique Mais la parfaite réussite de ce spectacle en tous points hors du commun réside aussi dans le traitement que lui réserve Yannis Kokkos, aux décors, à la mise en scène et aux costumes. Fantaisie fantastique. Le Grec touche en plein dans le mille. En jouant sur la projection vidéo, des décors à la simplicité raffinée, des costumes baroques et l’utilisation aérienne de perchoirs, Kokkos réveille l’onirisme de l’œuvre. De magnifiques animations filmées brossent les ambiances dans le mouvement, qu’il pleuve, vente ou neige. Au cœur de cette poésie, les belles lumières nocturnes de Patrice Trottier entretiennent leur part de mystère. Solitude rêveuse de Bonespoir, duos tendres ou fêtes animées: toutes les scènes bénéficient en outre d’un même sens de la musicalité. Le metteur en scène sait étirer le jeu, comme le ramasser dans l’espace. Il invite ainsi à passer du rêve éveillé aux caquètements agités d’une volière, sans aucun heurt dans le rythme des transitions. Plaisir à tous les niveaux Un vrai bonheur à dévorer sans retenue jusque dans la fosse. L’OSR se révèle en effet en grande forme sous la baguette inspirante d’Ulf Schirmer, qui libère l’ampleur et souligne les finesses de cette musique généreuse et délicate. Et quand l’alchimie fonctionne, il n’est pas étonnant de retrouver du plaisir à tous les niveaux. Celui du chant n’est donc pas épargné. Le rossignol cristallin de Marlis Petersen vocalise avec une légèreté de plume, sans souci apparent de l’altitude, sur son juchoir élevé. A ses séductions vocales, Bonespoir, on le comprend, ne saurait résister. Bien qu’un peu tendu en fin de course, le ténor réalise un sans-faute tout au long de son parcours initiatique. La voix plus développée et colorée, Duccio Dalmonte compose de son côté un Fidèlami sans complexes ni remords, alors que le Prométhée inquiet de Roman Trekel, la Huppe nostalgique et Brett Polegato et le roitelet énergique de Regina Klepper se détachent d’une solide équipe de volatiles. Mention spéciale, encore, au chœur de Ching-Lien Wu qui décidément, gagne avec les années une cohésion et une subtilité enviables. Yannis Kokkos nous déclarait pendant les répétitions du spectacle: "J’espère que cette production marquera une étape importante dans la réhabilitation de Braunfels." Ses vœux sont aujourd’hui exaucés... |
|
Libération lundi 02 février 2004 Opéra. A Genève, "les Oiseaux", fantaisie lyrique du compositeur Walter Braunfels banni par le régime nazi. Par Eric DAHAN L'oeuvre signée Walter Braunfels date des années 20. Mais si Decca ne l'avait pas enregistrée en première mondiale en 1994 dans sa collection "Entarte Musik", consacrée aux compositeurs "dégénérés" bannis par le régime nazi, elle aurait sans doute sombré dans l'oubli. Les Oiseaux firent pourtant un grand succès à Munich, Cologne, Stuttgart, Hambourg et Vienne, dans les deux ans ayant suivi leur création en 1920 sous la baguette de Bruno Walter. Après l'enregistrement Decca, la Volksoper de Vienne et l'opéra de Cologne ont proposé des productions scéniques de l'oeuvre en 1997 et 1998. Depuis le 24 janvier, le Grand Théâtre de Genève offre également une nouvelle production qui ne désemplit pas. On imagine la surprise de ceux qui s'étaient préparés à entendre des lambeaux de musique âprement atonale, ou tout du moins assez moderne pour provoquer la bêtise du national-socialisme. Dès l'ouverture, les cordes homogènes et les vents précis de l'Orchestre de la Suisse romande, sous la baguette d'Ulf Schirmer (récemment salué pour sa Femme sans ombre, à Bastille), dessinent un paysage aux couleurs étonnamment wagnériennes. On pense à Siegfried, puis aux Maîtres chanteurs, pour la verve lyrique si bien pensée. Une colorature vocalise dans une nacelle rouge traversant un ciel floconneux, et c'est le Richard Strauss d'Ariane à Naxos qu'on entend alors. En fait, le "dégénéré" n'avait pour seul défaut que d'être demi-juif, et hostile à la barbarie du IIIe Reich. Pour le reste, c'était un "conservateur", un humaniste. L'après-guerre ne sera du coup pas plus clémente avec lui. A côté d'un Stockhausen, Braunfels passera pour ringard. Ses Oiseaux, aux saveurs mozartienne, straussienne et wagnérienne, aussi chatoyantes que parfaitement ciselées, décrivent le rêve babélien interrompu par la loi de Zeus, d'une cité des oiseaux au milieu des nuages. Aguerri au fantastique théâtral avec Hansel et Gretel de Engelbert Humperdinck et Outis de Berio, Yannis Kokkos signe mise en scène, décors et costumes (soixante oiseaux différents) de cette allégorie de l'utopie dangereuse et, surtout, d'un monde de beauté menacé de disparition : "je ne supportais plus de voir l'art dégénérer", dit en toutes lettres le livret signé Braunfels. Si l'esthétique disparate du plateau laisse parfois perplexe, on ne saurait nier l'efficacité des images. De l'orage magnétique accompagnant la colère d'un Zeus, en Commandeur de métal géant, aux découpes bleutées accueillant un Prométhée fiévreux, Kokkos sait, grâce au recours à la technologie vidéo d'Eric Duranteau, donner à voir l'impossible dont sont tissés les songes. L'écriture vocale enchanteresse de Braunfels est servie par une distribution soignée, du Rossignol de la soprano Marlis Petersen au ténor Pär Lindskog en Bonespoir amoureux. Pour la poésie déployée par les pupitres genevois et le casting vocal, pour l'imagerie naïve échappée de l'Ile sur le toit du monde, ces Oiseaux mériteraient de migrer bientôt sous d'autres cieux. |
|
Les Echos 29 janvier 2004 OPÉRA Les ailes de l'espérance Une redécouverte qui s'imposait, magnifiquement servie par une production irréprochable. Walter Braunfels fait partie de ces compositeurs qui remportèrent, en leur temps, un succès considérable avant de tomber dans l'oubli, au point que certains dictionnaires spécialisés ne citent même pas son nom. Né en 1882, il délaisse le droit et l'économie pour se consacrer à la musique. Virtuose du piano - septuagénaire, il se produit encore en concert -, disciple du fameux chef d'orchestre Felix Mottl, il se lance dans l'opéra en 1909, avec " Princesse Brambilla ". En 1920, " Les Oiseaux " enthousiasment Munich ; ils sont magnifiquement servis par une distribution prestigieuse (la soprano Maria Ivogün, le ténor Karl Erb) et le grand Bruno Walter est au pupitre. Trois ans plus tard, Konrad Adenauer, maire de Cologne, sollicite la participation de Braunfels pour la création du nouveau Conservatoire. Cette brillante trajectoire s'arrête net en 1933 : catholique mais demi-juif par son père, adversaire farouche du national-socialisme, le compositeur est démis de ses fonctions, et ses oeuvres, interdites, sont rangées dans la catégorie " musique dégénérée ". Braunfels choisit de rester en Allemagne et se retire près du lac de Constance. Il retrouve son poste en 1945, mais le succès ne revient pas, la mode n'est plus à cette forme de romantisme. Il s'éteint en 1954. Il faut attendre les années 1990 pour que " Les Oiseaux " retrouvent la scène, 1994 pour qu'un enregistrement paraisse enfin chez Decca. Et l'on crie à nouveau au chef-d'oeuvre. L'auteur, adaptant la pièce éponyme d'Aristophane, a lui-même écrit son livret ; fidèle au dramaturge grec mais atténuant la satire au profit d'une vision poétique et métaphysique. Les hommes poussent les oiseaux à se révolter contre les dieux et à construire une cité idéale. Prométhée les met en garde. Mais la ville est bâtie, vite détruite par une tempête déchaînée par Zeus. Les oiseaux s'envolent. Les hommes regagnent la terre. L'un d'eux, troublé par le chant du rossignol, comprend qu'il ne sera plus jamais le même. Cette initiation au monde de la beauté, Braunfels la traduit en une narration musicale d'un néoromantisme tempéré qui rappelle parfois celui des " Maîtres chanteurs " wagnériens. La poésie règne L'écriture est d'une constante souplesse, unifiée par quelques thèmes conducteurs, l'instrumentation d'une infinie variété de couleurs, les climats contrastés, du plus fin comique, lorsque les volatiles lors de scènes très animées s'expriment par onomatopées, ou versant dans la plus pure élégie, dans le duo de Bonespoir et du Rossignol qui ouvre l'acte II- une pure merveille. Aucun détail n'échappe à la baguette précise et chaleureuse d'Ulf Schirmer, et la partition, rayonnante et chatoyante, éblouit. Pas la moindre faille dans la distribution vocale. A chaque homme sa personnalité et son timbre, Bonespoir (le ténor Pär Lindskog), qui ouvre son coeur, Fidélami (le baryton Duccio Dalmonte), gentil mais prosaïque. A chaque oiseau, sa voix, Regina Klepper (le Roitelet), séduisante, Brett Polegato (le roi La Huppe), plastronnant, escortés de mésanges, hirondelles, grives, flamands. Et le Rossignol, dont le chant aérien ouvre et conclut l'ouvrage : Marlis Petersen, lumière et cristal, y est envoûtante. La réussite de ces " Oiseaux ", c'est aussi celle de Yannis Kokkos. Sa mise en scène est sans détour, sa direction d'acteurs simple et efficace. Aidé par les images vidéo d'Eric Duranteau, il a imaginé un monde féerique et touchant, cimes neigeuses et cieux immenses. On pouvait redouter l'effet Disney et sa mièvrerie ou, à l'inverse, la caricature ; les deux sont évités, la poésie règne à chaque minute. Un seul regret : qu'une telle production n'ait pas été filmée. Sera-t-elle seulement reprise? MICHEL PAROUTY |
|
ResMusica.com 5.2.2004 " Les Oiseaux " au Grand Théâtre de Genève Bernard Halter La cage de l’oubli a été rouverte ! Les volatiles qui y étaient maintenus prisonniers retrouvent enfin la liberté ! Hourra ! Mais qu’est-il donc arrivé à ce bestiaire de volatiles rassemblés pour le Singspiel de Walter Braunfels créé à Munich en 1920 par Bruno Walter ? La réponse se pressent. Si un chef d’œuvre qui a vu le jour en Allemagne disparaît dès 1933 de l’histoire de la musique — ou peu s’en faut —, c’est que le régime nazi a cherché à le recouvrir de sa boue pestilentielle et brunâtre. Entartré par les tristement célèbres mesures qui en ont fait un compositeur " dégénéré ", Braunfels a été mis à l’index par les sbires de Hitler. Pourtant, cet allemand natif de Frankfort sur le Main, converti au catholicisme au sortir de la Première Guerre mondiale, ne présente ni les caractéristiques avant-gardistes, ni la judaïcité de ces pairs dont la production a été broyée par la déferlante idéologique nazie. Pendant la décade qui suit 14-18, Braunfels est même l’un des compositeurs les plus en vogue. Il coule des jours heureux à Cologne où il occupe un poste à l’Université. Son art, plus ostensiblement tourné vers le dix-neuvième siècle finissant que celui des Berg et autres Toch et Schreker, exerce une séduction immédiate sur le public et fait de sa musique l’une des plus fréquemment jouées. Cultiver le succès ne signifie pas pour autant ronronner dans l’insouciance. Très vite, Braunfels se montre sceptique à l’égard du Troisième Reich ; il refuse d’écrire l’hymne que les nazis désiraient de lui dans les années vingt, bien avant leur main basse sur le pouvoir. Lorsque ce dernier est raflé et que la violence en latence se met à opérer, Braunfels est immédiatement démis de ses fonctions et son œuvre estampillée " Entartete Musik ". Courageux, l’artiste optera pour un demi-exil. Il passera les années de guerre au bord du Lac de Constance, à quelques kilomètres à vol d’oiseau de la très neutre Helvétie. Au sortir de 39-45, les consciences ont été irrévocablement transformées par la découverte de l’existence des camps de concentration. L’art rompt radicalement avec le passé. Un deuxième ostracisme, lié cette fois-ci à des enjeux esthétiques, va avoir raison de l’essor de la carrière de Braunfels considéré désormais comme irrémédiablement daté et d’une insoutenable légèreté. Il fallut attendre 1971 pour voir réapparaître les Oiseaux sur scène, à Karlsruhe plus précisément. Puis le formidable champ d’investigations qu’offre cette partition a de nouveau connu une période de jachère qui a duré jusqu’à la production de l’Opéra de Brême en 1991. Vienne, par la suite, a accueilli l’ouvrage qui est resté plusieurs saisons à l’affiche. Les Oiseaux, peu migrateurs au demeurant, ont été tellement discrets jusqu’à ce jour que la production genevoise est la création suisse ! Précisons encore que les intéressés qui n’ont pas eu l’occasion de découvrir cette pièce peuvent se rabattre sur l’enregistrement paru chez DECCA dans la série consacrée, il y a quelques années, à l’Entartete Musik. Une collection qui offre un large panel d’œuvres incontournables pour qui veut embrasser plus largement encore la compréhension de ce siècle si pluriel que fut le dernier écoulé. Les Oiseaux semblent contenir prioritairement tous les ingrédients de la farce caustique et critique. S’il n’est pas possible d’escamoter complètement cette dimension, force est de constater, peut-être à regret, que ce n’est pas là la composante prédominante du livret. Cette fantaisie lyrique en deux actes puise certes son inspiration chez Aristophane (Ve siècle avant J.-C.) qui dans la pièce éponyme brocarde l’Athènes antique et se gausse avec virulence de ses travers. Le livret, qui émane de la plume du compositeur, met pour sa part en scène deux hommes fatigués par la vie terrestre qui recherchent le bonheur paradisiaque du monde des oiseaux, sorte d’univers éthéré et idéal suspendu entre ciel et terre. L’idée romantique de l’exil prend chez Braunfels clairement le pas sur la dimension plus exclusivement politique de l’auteur grec. Le départ des deux hommes n’est toutefois pas une ultime errance assortie du Grand Saut dans l’au-delà à la façon de l’Abschied de Mahler. Leur voyage, qui contrairement à celui de Schubert n’a pas de saison, ne se ponctue pas avec la rencontre du joueur de vielle. Leur envol, s’il répond plus à un espoir qu’il n’est l’écho d’un désarroi mortifère, demeure motivé par une sensation de mal-être pleinement romantique. Fidèlami désire échapper à la déchéance d’un monde terrestre et prosaïque dont il ne peut s’accommoder alors que Bon Espoir cherche à oublier les tourments de l’amoureux éconduit. En chemin, il rencontre le Roitelet, serviteur du Roi Huppe. Porté par son statut de dissident, Fidèlami, l’archétype de l’idéologue mégalomane, convainc les oiseaux de bâtir une cité et d’extorquer aux dieux du Royaume de Zeus les fumées émanant des sacrifices faits par les hommes en guise d’offrandes. Le Rossignol convoque alors ses semblables pour que toutes et tous s’affairent en vue de la réalisation de ce projet. Fidèlami rêve d’hégémonie et se mue en un véritable meneur alors que Bonespoir tombe sous le charme du Rossignol et se prélasse dans la féerie qui s’offre soudainement à lui. La relation que ce dernier va établir avec celui-ci, bien que de nature amoureuse, lui amènera surtout la découverte des sensations de bonheur dont le leste oiseau nourrit son âme et son cœur. Pendant ce temps-là, la ville fortifiée prend forme. Prométhée, qui jadis brava les divinités, vient mettre en garde les oiseaux contre le courroux de Zeus. Fanatique et résolu, Fidèlami veut à son tour tenir tête aux dieux. Zeus détruit d’un seul souffle la cité saugrenue qui le nargue si bien que les deux hommes sont forcés de renouer avec leur condition terrestre. Fidèlami rentre amer, avec sa fibre de tribun chevillée au corps. Bonespoir s’en retourne nostalgique mais avec la certitude d’avoir trouvé un sens à sa vie puisque cette aventure céleste, pour onirique qu’elle fut, n’en demeura pas moins vécue intérieurement. Jusqu’au dernier moment, chant caressant de l’oiseau enjôleur l’accompagne. Le livret oscille donc entre un pôle politique, voire religieux, et un conte exaltant le merveilleux et cultivant l’art du Beau. Aux entournures, le domaine des Oiseaux et l’aventure initiatique de Bonespoir rappelle les personnages peuplant l’Atlantide du Vase d’Or d’E. T. A. Hoffmann. Comme chez l’auteur allemand, le romantisme et le merveilleux se mêlent dans une alchimie particulière. D’un autre point de vue, le texte de Braunfels épingle la soif de pouvoir, réaffirme sous le déguisement de la mythologie grecque l’attachement du compositeur au monothéisme chrétien et l’idée d’omnipotence de Dieu, tout en déployant une myriade d’éléments de la plus pure féerie. C’est à cette dernière composante que le metteur en scène Yannis Kokkos a voué l’essentiel de son travail. Auteur des décors et des costumes, il a créé un univers atemporel baignant dans des éclairages explicites et merveilleusement conçus. Tout invite à l’ascension, à commencer par les arbres stylisés disposés comme des vecteurs orientés vers les domaines célestes. L’espace scénique sur lequel évoluent les acteurs est plutôt dépouillé, comme exempt de repères permettant de le situer à l’aune de références terrestres. Le rêve y est pleinement possible, sans limites. Les chorégraphies ornithologiques, pittoresques et stéréotypées à la fois, viennent prolonger une direction d’acteurs qui joue avantageusement avec le mouvement. Plus encore que la richesse des éclairages, les costumes bigarrés, tous différents sont d’un luxe inouï et ne sont pas sans rappeler le carnaval de Venise dans ce qu’il a de plus fastueux. Le travail titanesque de l’homme de théâtre a quelque chose de baroque par son ampleur. Ses tableaux sont très personnels et magnifient un ouvrage qui en devient inclassable, sans jamais confiner au kitsch. De ce point de vue esthétique, la scène se révèle le parfait miroir de la fosse. Une conjonction rare, parce que difficile, qu’Ulf Schirmer placé à la tête d’un Orchestre de la Suisse Romande extraordinairement fantasque est pleinement parvenu à réaliser ! La partition des Oiseaux est touffue, ample. Elle présente parfois des couleurs extrêmes tout en demeurant de façon générale d’une grande limpidité. Ses lignes se déploient par le truchement de ces longs développements ininterrompus caractéristiques du genre postromantique. Le recours au procédé du leitmotiv permet de ponctuer le discours musical, agrémenté au surplus de la féerie foncièrement pittoresque et pastorale d’une écriture qui ne craint pas, en 1920, de renouer avec les charmes de la musique imitative. Mais la principale fascination qu’exerce l’œuvre de Braunfels demeure le rapport qu’elle entretient avec le chant. Le compositeur confie au Rossignol des airs et des vocalises ahurissantes susceptibles de supplanter en virtuosité Lakmé, Zerbinetta ou la Reine de la Nuit. Et quel bonheur de découvrir cette grâce musicale et virtuose par l’intermédiaire de la soprano Marlis Petersen ! Merveilleusement juchée dans les airs sur un son cerceau, l’Allemande a le charme et le talent pour le rôle. Le ténor Pär Lindskog (Bonespoir) donne admirablement la réplique. Sans vibrato malvenu, il émet avec puissance un chant radieux parfait pour l’opéra allemand. Son timbre est naturel et ne présente pas les artifices formatés de certains de ses homologues de tessiture. L’autre élément du tandem constitué par les deux terriens en exil, Fidèlami, alias Ducci Dalmonte, basse, livre son chant à gros traits, dans un allemand qui reste impeccable. Son style est parfois comique (?), un peu balourd au niveau du jeu si bien qu’en certaines occasions, il semble que le soupçon de hargne conquérante que son personnage appelle pourtant lui fait défaut. Le Prométhée campé par le baryton Roman Trekel est violent, autoritaire, inflexible. Parmi les rôles secondaires, citons encore l’excellente Regina Klepper (Le Roitelet) ou l’élégant Brett Polegato (La Huppe) ainsi que le vaillant Kenneth Cox (L’Aigle, Zeus). Le chœur, toujours placé sous la responsabilité de Ching-Lien Wu, ne dépareille pas avec la très bonne tenue de l’entier de la distribution. Les Oiseaux de Braunfels ont piqué du nez à deux reprises : Ils ont pris du plomb dans l’aile du temps des nazis, et se sont retrouvés le bec dans l’eau au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, faute de se trouver en adéquation avec les nouveaux dogmes esthétiques. Plusieurs décennies après, leur boîte noire est enfin retrouvée. Elle réhabilite désormais pleinement un compositeur que l’on espère voir décliné dans toutes ses tonalités, que ce soit sur scène ou en concert, avec des serviteurs aussi inspirés que ceux qui signent cette admirable création suisse. Genève . Grand Théâtre, le 30.I.04. Fantaisie lyrique en deux actes de Walter Braunfels: Les Oiseaux (Nouvelle production, création suisse). Mise en scène, décors et costumes Yannis Kokkos. Dramaturgie Anne Blancard. Lumières : Patrice Trottier. Mouvements chorégraphiques : Richild Springer. Roman Trekel, Brett Polegato, Marlis Petersen, Regina Klepper, Pär Lindskog, Duccio Dalmonte. Orchestre de la Suisse Romande, Chœurs du Grand Théâtre. Direction musicale : Ulf Schirmer. |
|
Les Oiseaux chantent à Genève Didier van Moere Qui connaît aujourd'hui Walter Braunfels (1882-1954), juif converti au catholicisme que les nazis mirent au ban de la vie musicale allemande et qui ne parvint pas à émerger à nouveau après la guerre, victime cette fois des ayatollas du sérialisme à tout va, bien que Konrad Adenauer lui eût confié le Conservatoire de Cologne ? Il eut pourtant son heure de gloire et ses Oiseaux, que Decca exhuma dans le cadre de sa série « Musique dégénérée » et que vient de monter l'Opéra de Genève, furent créés avec succès en 1920, à Munich, par le prestigieux Bruno Walter. Braunfels s'inspire de la comédie d'Aristophane où Bonespoir et Fidèlami, déçus par la méchanceté du monde et les turpitudes de leur patrie athénienne, poussent les oiseaux à se révolter contre les dieux pour instaurer un monde meilleur. Mais le musicien, gommant les allusions à l'actualité de l'Athènes d'Aristophane tout en ouvrant la porte à des interprétations fondées sur celle de sa propre époque, donne à l'histoire un sens différent : les oiseaux refusent ici de suivre les conseils de Prométhée qui les met en garde contre son propre exemple ; ils sont aussitôt impitoyablement défaits par Zeus et célèbrent alors la grandeur de celui qu'ils ont si imprudemment bravé. Dieu doit rester garant de l'équilibre du monde. Fidèlami reviendra à sa grisaille quotidienne, mais Bonespoir, qui a chanté avec le Rossignol, au deuxième acte, un duo parfois proche de celui de Tristan, a été initié aux mystères de la nature et en a été profondément transformé. La forêt, dans cet acte, tient à la fois de celle de Hänsel et Gretel de Humperdinck et de celle de Siegfried. Comme le Waldvogel wagnérien, le Rossignol est un médiateur - féminin, étant donné le genre du mot allemand. Un beau rôle de soprano colorature, où Braunfels, pensant peut-être à l'exemple de la Zerbinette d'Ariane à Naxos de Strauss, renouvelle une des conventions à la fois les plus spectaculaires et les plus creuses de l'opéra traditionnel. La musique elle-même est très post-wagnérienne et l'auditeur averti repère aisément des réminiscences de telle ou telle partition du maître de Bayreuth. Cela peut d'ailleurs sonner aussi très straussien, comme ce thème de Zeus qui rappelle la Symphonie alpestre. Mais il y a là une fluidité toute classique montrant de la part de Braunfels une nostalgie du classicisme, comme si la défaite des oiseaux n'était que la sanction de l'aspiration désordonnée à une modernité excessive. Partout, l'hybris est donc punie. La production genevoise est une indéniable réussite. Yannis Kokkos trouve le juste équilibre entre le réalisme et le féerique, n'appuyant jamais la dimension symbolique de l'oeuvre, qui se dégage d'elle-même. C'est visuellement très beau, avec ces oiseaux bigarrés, ces décors stylisés, ces effets de lumière nous faisant osciller entre deux mondes, notamment au deuxième acte, où les arbres de la forêt semblent découpés par des enfants. Ulf Schirmer évite toute emphase et obtient de l'orchestre une parfaite transparence sans pour autant oublier les exigences du théâtre ; on regrette seulement, comme dans sa Femme sans ombre parisienne, que cette exactitude ne se nimbe pas davantage de poésie. Du côté des chanteurs, le Rossignol de Marlis Petersen domine la distribution, par son aisance et la subtile humanité de sa caractérisation. Une mention aussi pour le délicieux Roitelet de Regina Klepper, ou pour le Bonespoir de Pär Lindskog, très à l'aise, même s'il ouvre un peu dangereusement les sons, dans un de ces éprouvants rôles de ténor très caractéristiques de l'opéra post-wagnérien. Certains, en revanche, s'ils chantent avec style, sont plus timides de projection, comme le Fidèlami de Duccio Dalmonte, belle basse profonde au demeurant, ou surtout le Prométhée de Roman Trekel, Liedersänger manquant de puissance et court de grave, sans parler de la Huppe de l'insuffisant Brett Polegato. Cela dit l'ensemble du spectacle est d'une telle séduction que l'on passe volontiers sur ses - relatives - faiblesses. Une fois de plus, c'est Genève qui nous rappelle que la mission d'un opéra n'est pas seulement de maintenir un répertoire, mais de réparer les injustices. Copyright © ConcertoNet.com |
|
GENEVE: LES OISEAUX Jacques SCHMITT Perchés sur des fils descendus des cintres, battant spasmodiquement d'une aile comme pour se débarrasser d'une petite vermine ou pour remettre une plume en place, des hommes-hirondelles surplombent une cour d'oiseaux-femmes de toutes espèces et couleurs. Tout ce monde piaille allègrement la joie d'appartenir à leur espèce, sans se soucier des hommes qui les surveillent. C'est le mariage de deux tourterelles toutes de blanc vêtues, entourées de grives, de mésanges et autres autruches. Le tableau est charmant, coloré, envoûtant. Sous prétexte de protéger cette admirable harmonie contre les assauts d'un mal inconnu, les hommes proposeront aux oiseaux de construire une citadelle dans laquelle ils seront à l'abri du danger. Ils acceptent mais, voyant que le dessein de l'homme est de diriger ce royaume, les oiseaux finiront par chasser les hommes. Cette imagerie poétique, ce conte animal à partir duquel Walter Braunfels crée son opéra est issu d'une fable qu'Aristophane avait écrite à la suite de l'expédition d'Athènes contre Syracuse. Si l'oeuvre que le compositeur a en a tirée est moins centrée sur cette course au pouvoir, elle éclaire néanmoins chacun sur l'opposition de celle-ci à la spiritualité, à la découverte de la beauté pour elle-même. Ainsi Fidèlami, l'un des protagonistes de l'opéra, matérialiste et manipulateur, partira déçu et fâché vers d'autres conquêtes, alors que Bonespoir vivra dans les délices du rêve, de l'artiste pur après sa rencontre amoureuse avec Le Rossignol. Créé en 1920, Les Oiseaux de Walter Braunfels devaient avoir un destin cruel puisqu'ils disparurent des scènes lyriques en 1933, année à partir de laquelle les oeuvres de Braunfels furent interdites par le gouvernement d'Hitler. Jugées ringardes après la guerre, elles tombèrent dans l'oubli, jusqu'à une épisodique résurrection en 1971. Depuis, Les Oiseaux ont fait l'objet de quelques représentations par-ci par-là, comme cette production genevoise faisant office de création suisse. S'apparentant à Richard Strauss pour la ligne mélodique et à Giacomo Puccini pour la subtilité des arrangements, la musique de Walter Braunfels est un enchantement. La baguette avisée du chef allemand Ulf Schirmer a su plier un excellent Orchestre de la Suisse Romande aux désirs du chant. Douceurs extrêmes du Rossignol, rudesse d'archets du Roitelet, pur miel de la poésie de Bonespoir. Tout comme Chantecler d'Edmond Rostand, Les Oiseaux demande un matériel scénique complexe. Hormis les deux personnages "humains" de l'opéra, tous les autres protagonistes sont déguisés en oiseaux. Il n'est donc pas de costumes identiques. Reconnaissant l'importance de chacun, le metteur en scène Yannis Kokkos a désiré que chaque acteur, du figurant au choriste, choisisse son "oiseau". A la fois décorateur, costumier et metteur en scène, Yannis Kokkos combine ici ses talents multiples pour construire l'unité poétique de son spectacle et offrir une lecture délicate du conte d'Aristophane. Jeux d'ombres et de lumières dans un décor de contes pour enfants, sa forêt est habitée des sapins identiques à nos dessins d'enfance, ses montagnes sont puérilement pointues, ses prés sont aux couleurs de nos fantasmes infantiles, roses ou émeraude. Avec cette imagerie des livres de notre prime jeunesse, le climat du metteur en scène grec enrobe d'insouciance juvénile la fable d'Aristophane. Ainsi le spectateur n'y verra que ce que son imagination lui dictera. Le conte merveilleux ou les débordements de l'ambition humaine. Les Oiseaux est un hymne à la voix féminine. Ainsi, Braunfels donne au Rossignol les airs - évidemment - les plus aériens qui soient. Suspendue dans les airs, la soprano allemande Marlis Petersen (Le Rossignol) y prête sa splendide colorature. Jouant de la grâce de ses gestes et de sa voix, elle conquiert l'espace avec des vocalises stratosphériques qui ne sont pas sans rappeler une certaine Natalie Dessay ! A ses côtés, la voix toute de rondeur mozartienne du ténor suédois Pär Lindskog (Bonespoir) s'accorde le bonheur d'une parfaite symbiose à la quête éperdue de cet inaccessible rêve aérien. La basse italienne Duccio Dalmonte (Fidèlami) n'hésite pas à colorer son chant d'accents frustes pour illustrer la dureté antipathique de son personnage égaré dans cet univers féerique. Le tableau vocal serait incomplet sans signaler l'extraordinaire présence de Roman Trekel (Prométhée). Figure exsangue d'un héros à l'agonie, le baryton allemand galvanise le plateau avec son personnage d'outre-tombe. A noter encore l'excellence du Choeur du Grand-Théâtre de Genève qui, au fil des productions lyriques, révèle ses qualités vocales jusqu'ici comme peu exploitées. Magnifique ! (A quand un concert de cet ensemble?) Incontestablement meilleure production du Grand-Théâtre de Genève depuis l'arrivée de son nouveau directeur, Jean-Marie Blanchard, il faut espérer que ce spectacle féerique aura suscité l'envie à d'autres théâtres de monter l'ouvrage. Et qu'enfin Les Oiseaux reprenne la place qu'il n'aurait jamais dû quitter aux côtés des "classiques" de la scène lyrique. |
|
Auf hochfliegende Gedanken werden Steern erhoben GENF, Ende Januar. Fortschritt ist eine trügerische Brücke. Sie führt, zumindest in der Musik des zwanzigsten Jahrhunderts, nichts unbedingt weiter, sondern manchmal in die Sackgasse. Daß das Bessere stets vor uns liegt, daß der Fortschritt des musikalischen Materials unaufhaltsam von A nach B und immer weiter geradehaus saust, Sind Gewißheiten, die aus dem Jahrhundert der Eisenbahnen stammen und mittlerweile zweifelhaft geworden sind. Heute müssen selbst die letzen großen Adorno-Ausleger in der Musik, Heinz Klaus Metzger oder Rainer Riehn, nicht mehr automatisch lächeln, wenn sie einen Dreiklang hören. Und die einst des Rückschritts neuer Einfachheit bezichtigte Wolfgang Rihm beantwortete Metzgers Frage "Was heißt Fortschritt?" 1998 frecht mit freien Versen wie: "Fortschritt ist seiner Natur gemäß immer fort / Nie dort wo man ihn weiß … Man stochert in Nebeln und greift in die Luft und unter die Betten / Das alles ist abseits des Festes." Klingt lustig, ist aber nicht nur Spaß. Seiner Nichtgreifbarkeit zum Trotz hat der Fortschrifftsbegriff doch handfesten musikalischen Flurschaden angerichtet, vor allem in Deutschland, in den Fünfzigern, als eine traumatisierte Avantgarde die Stunde Null in der Musik ausrief. Seither wurden Werke vor allem jüdischer Komponisten, die durch die Nazionalsozialisten ausgegrenzt worden waren, gleich noch einmal der Furie des Vergessens zum Fraß vorgeworfen – aus ästhetischen Gründen, dem Fortschrit zulkiebe. Ja, noch in den Neunzingern urteilte man über ein so ideensprühendes Werk wie die wieder aufgetauchte Oper "Die Vögel" von Walter Braunfels mit streng fortschrittspolizeilichem Vokabular, es sei "konventionell", biete "nicht Neues" und weise über "verbrauchte Mittel und wege des 19. Jahrhunderts" nicht hinaus. Das Grand Théâtre de Genève hat nichtsdestotrotz nun zum fünften Mal (nach Karlsruhe 1971, Bremen 1991, Köln 1998 und Wien 1999) einen Versuch unternommen, die "Vögel" ins Leben zu rufen. Er ist grandios geglückt. Nicht zuletzt, weil der Regisseur Yannis Kokkos der Braunfelsschen Partitur vertraut und ihre Poesie nicht übermalt. Es beginnt zu schneiden auf dem geschlossenen Bühnenvorhang, während sich, zunächst nur als dünner Violinenfaden, das triolenbetupfte Leitmotiv der utopischen Luftstadt uas dem Graben aufschwingt. Die Flocken scheinen liegenzubleiben, sie formieren eine Landschaft aus Schnee – Tannen, Berge, Wolken –, während Klarinetten und Fagotte den Melodienbogen abfangen, harmonisch fundieren, währende dann nach und nach auch Harfen, Flöten, Hörner aufblühen und schließlich das volle romantische Symphonieorchester zur Attakke ausholt. Geht der Lappen hoch, sieht man ebendiese wie im Scherenschnitt gefertigte Landschaft, leicht verschoben, und aus dem Schnürboden schwebt die Nachtigall und singt ihr Perlentrillern und kollernden Koloraturbändern besticktes Begrüßungslied. Eine höhenglitzernde Königin-der-Nacht-Arie, zugleich ein kokettspitzes Zerbinetta-Couplet: Es handelt vom Glück der Sehnsucht und will Ich-weiß-nicht-wohin. Und Marlis Petersen, die diesem Vogelgesang genau das passende kunstvoll-naive Timbrezu geben weiß, hat die Hörerschaft im Handumdrehen auf einen anderen Stern entführt. Ähnlich wie in Rameaus "Platée" oder in Janá čeks “Schlauem Füchslein” sprechen auf diesem Stern die Tiere mit den Menschen – nicht über Niedlichkeiten und Nichtiges, vielmehr über das richtige Leben im falschen und über Bedarf an und Scheitern von Utopien. Da gibt es Liebeserklärungen and den Mond, Schlager, die sofort ins Ohr gehen, gewaltige Chöre, reißende Melodienströme und eine leuchtende, unerhört farbenreiche Instrumentation. Tatsächlich hat Braunfels seine Melodik teils direkt aus Vogelrufen abgleitet, sie verzweigt sich freilich anders als bei Messiaen und eigentümliche Abwege. Im ersten Akt folgt die Oper, zu der der Komponist sich selbst das Libretto schrieb, noch eng der Aristophanischen Komödie. Im zweiten brechen dann flächige, wagnerische Musiknummern – ein ausuferndes Duett, ein großer Monolog – das leichtfüßig Fabelhafte auf: Und die Tragödie beginnt.Die zwei Wanderer, denen die enge Menschengesellschaft zuwieder geworden ist, bringen Verdruß ins freie Reich der Vögel. Ratefreund (Duccio Dalmonte), ganz Bariton und Praktikus, stiftet sie zum Aufstand gegen die Götter an und initiiert den Bau einer Wolkenstadt, die Steuern erheben soll für aufsteigende Gebete, hochfliegende Gedanken. Der Tenor und Traumtänzer Hoffegut (Pär Lindskog) verliebt sich derweil in die Nachtigall, die seinethalben aus der Luft herabsteigt und sich in einer blauen halben Stunde in herrlich-tristaneskem Tête-à-tête verströmt. Gleich anschließend tunkt der Auftritt des Prometheus die Utopie in schwarze Tinte. Baßbariton Roman Trekel verleiht der Figur dramatische Wucht, zunächst als dumpf murmelnde, von Zeus abhängige Marionette – dann, aus dieser Funktion heraustretend, singt er in einem wild-wotanesken Monolog von der Vezweiflung des eignen Scheiterns. Folgen Krieg, Donner, Sturm, Blitz und Untergang: Am Ende liegt das freie Vogelreich der Vögel in Schutt und Asche und die Bühne voll abgerissener Flügel. Ganz ist Kokkos, der selbst all die fabelhaften Federkostüme entwarf, der Gefahr dekorativer Märchentümelei nicht entgangen. Zumal die Tableaus der Vogel-Vollversammlung und der Taubenhochzeit streifen mit ihrem Trippeln, Picken, Ruckedigu und der ganzen Piepmatzerei hart an die Kitschgrenze. Dafür treffen die schlichten Bilder stiller Katastrophen um so präziser. "Ich hab’ gelebt", ruft traurig der Tenor, allein zurückgeblieben auf dem Feld des Desillusionen – als sei das Trost und keine Strafe. Gesungen wurde auf höchstem Niveau. Das Orchestre de la Suisse Romande entfaltete unter Ulf Schirmer nicht ganz rückhaltlos die volle Pract der Partitur. Ingesamt wird diese Produktion, die als Votum für die Repertoirefähigkeit der "Vögel" gelten darf, nur sechsmal in Genf zu erleben sein, was viel ist angesichts der Finanz- und Sachzwänge eines mittleren Stagione-Betriebs heutztage. Als das Stück 1920 in München unter Bruno Walter uraufgeführt worden war, ging es gleich mit fünfzig Aufführungen in Serie. Auch ein Beispiel dafür, daß das Bessere manchmal hinter uns liegt. ELEONORE BÜNING |
|
OPER Von Karsten Unlauf Genf. In einem Meer von Lichtpunkten gleitet man hinüber in die Fantasiewelt mit gezackten Tannen - wie von Kinderhand geschnitten. Hier treffen sich König Wiedehopf und seine Untergebenen: Zaunschlüpfer, Drosseln, Krähen, Kiebitze, Adler, Flamingos. In Walter Braunfels' Oper "Die Vögel", bauen sich Piepmätze auf Anregung der weltflüchtigen Menschen Hoffegut und Ratefreund zwischen Himmel und Erde eine Stadt. Um den Opferrauch der Menschen von den Göttern fern zu halten, den die zum ewigen Leben brauchen. Sich also trotz aller Warnungen des leiderprobten Prometheus selbst über Zeus erheben. Braunfels hat den Stoff bei Aristophanes gefunden und dessen Kritik an der athenischen Politik in ein christlich gefärbtes Gotteslob gewendet. Denn am Ende triumphiert der Gott: Vögel und Menschen müssen in hymnischen Tönen seine Übermacht anerkennen. Vielleicht hat Braunfels auch diese Verankerung im Christentum im Weg gestanden, als es nach dem 2. Weltkrieg galt, sein als "entartet" diffamiertes Werk wieder zu entdecken. Entscheidender war wohl, dass die 1920 mit großem Erfolg uraufgeführte Oper alles andere als modern ist. Sie wurzelt im spätromantischen Humus, verfeinert mit der Instrumentationskunst eines Berlioz. Außerdem verharrte der konservative Braunfels während der Nazidiktatur in der "inneren Emigration", und damit wollte man im avantgardistischen Aufbruch der Stunden Null nichts anfangen. Dass der erste Rektor der Kölner Musikhochschule bis heute nicht richtig auf Opern- und Konzertbühnen angekommen ist, ist ein eklatantes Versäumnis. Da kann man nun der mustergültigen Genfer Aufführung dankbar sein. Ulf Schirmer entfaltet mit dem Orchestre de la Suisse Romande prächtiges Farbenspiel. Da bleibt von der nie spröden, aber wenig süßlichen Partitur keine Delikatesse unbemerkt. Auch weil der Chor selbst im Forte noch so weich und transparent bleibt, wie man es kaum für möglich halten mag. Braunfels' Melodien perlen wie Champagner aus Sängerkehlen. Marlis Petersen (Nachtigall) scheint ihre Spitzentöne direkt aus dem Mondlicht zu schöpfen. Eine Sopranistin der Extraklasse, die das mit Pär Lindskog (Hoffegut), Roman Trekel (Prometheus) und Regina Klepper (Zaunschlüpfer) sehr gut besetzte Solistenensemble noch überstrahlt. Yannis Kokkos in eigenen Bildern übersetzt das in einen atmenden Licht- und Formenraum samt farbenfrohen Vogelkostümen für Tukane, Strauße, Pinguine. Das utopische Vogelreich als märchenhaftes Traumspiel. Nicht die Neuerfindung der Welt, aber ein deutlicher Flügelschlag der Poesie. |
|
Im Reich der Nachtigall Bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten war der 1882 in Frankfurt geborene Walter Braunfels einer der erfolgreichsten und meistgespielten Komponisten seiner Zeit. Dann, 1933, wurde er als Direktor der Kölner Musikhochschule abgesetzt, 1938 erhielt er Aufführungsverbot, ging in die "innere Emigration" und überlebte den Krieg am Bodensee. 1945 folgte er einem Ruf Konrad Adenauers und kehrte an seine frühere Wirkungsstätte zurück. Doch mit dem einstigen Erfolg war es vorbei, seine Werke werden seither nur noch sehr vereinzelt gespielt, wie jetzt die 1920 in München uraufgeführten "Vögel" im Genfer Grand Théâtre. Nicht nur die Biografie des Komponisten legt es nahe, dieses Werk unter politischen Vorzeichen zu lesen. Schon die Komödie des Aristophanes, nach der Braunfels sein Libretto verfasst hat, ist ein politisches Stück, ein Antikriegsstück. Und Braunfels stand unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs, als er diese Oper schrieb. Frappant sind aus heutiger Sicht allerdings vor allem die antizipierenden Elemente der Handlung. Der Kleinbürger aus der Menschenwelt, der ins Reich der Vögel eindringt, diese zum Bau einer Stadt aufruft, damit sie ihre frühere Macht und ihr Ansehen wiedergewännen und sich Götter und Menschen untertan machten - er sollte nur zu bald reale Gestalt annehmen, genauso wie der Sturm, der die zwischen Erde und Himmel errichtete Stadt zerstört. Doch Braunfels hat sein Opus 30 "Lyrisch-phantastisches Spiel" genannt, und in seiner Musik gibt es keinen Reflex des zeitgeschichtlichen Umfelds, weder des überstandenen Krieges und der gescheiterten sozialen Revolution noch des heraufziehenden Unheils, sie schwelgt in spätromantischem Klangrausch, raffinierter Farbenpracht und strömender Melodik, vermischt Anklänge an Wagner und Strauss mit den lautmalerisch komponierten Vogelstimmen zu einem betörenden, aber schwer definierbaren Amalgam. Dieses verfehlt auch in der Genfer Aufführung seine Wirkung nicht. Der Dirigent Ulf Schirmer versteht sich darauf, Braunfels' Musik zum Leuchten und Strömen zu bringen, obwohl das Orchestre de la Suisse romande am Premierenabend nicht in Bestform antrat, und hält den riesigen Apparat souverän unter Kontrolle. Es ist, neben dem exzellenten Chor (Leitung: Ching- Lien Wu), ein vielköpfiges Ensemble, dem, in luftigen Höhen auf einer Ringschaukel schwebend, Marlis Petersens Nachtigall ein mirakulöses Glanzlicht aufsetzt. Vertrackte Läufe, Triller und Koloraturen in höchster Lage scheinen für sie das reinste Vergnügen zu sein, sie intoniert nicht nur lupenrein, sondern auch mit einer in diesem Stimmfach seltenen Wärme und Weichheit. Begreiflich, dass der poetische Hoffegut ihr selig lauscht, schade jedoch, dass Pär Lindskogs schön timbrierter, aber unstabiler Tenor dem schwärmerischen Entzücken nur mangelhaft Ausdruck zu geben vermag. Auch Duccio Dalmontes Ratefreund bleibt darstellerisch und stimmlich durchaus Erdenmensch, kein charismatischer Volksaufwiegler, sondern ein spröder Rationalist. Mächtig tritt dagegen die Götterwelt in Erscheinung, als deren Bote Prometheus nicht nur riesenhafte Gestalt erhält, sondern von Roman Trekel auch mit imposanter Baritonstimme ausgestattet wird. Der aussergewöhnliche Beifall am Ende der Premiere galt aber wohl ebenso sehr der szenischen wie der musikalischen Wiedergabe. Yannis Kokkos als Regisseur und Ausstatter in einer Person hat sich konsequent dem Phantasiespiel verschrieben und setzt dieses mit einer ganz eigenen Bildsprache in Szene. Sie beruht auf immer wieder wechselnden Kombinationen von Dreiecken, die bald Berge, bald Tannen darstellen und mit wundersamen Pastellfarben gepaart werden. Lichteffekte, Videoprojektionen und verschiedenartigste Vogelkostüme tun ein Übriges, die Bühne zu einer Märchenwelt zu machen. So wird denn der einstige Erfolg von Braunfels' Oper durchaus nachvollziehbar. Auch deshalb ist die Aufführung der Vögel" im Grand Théâtre - laut Programmheft die erste in der Schweiz - eine Tat, die in die Rezeptionsgeschichte des Werkes eingehen wird. Marianne Zelger-Vogt |
|
Opulentes Zwitschern Premiere von Walter Braunfels' Oper "Die Vögel" in Genf. Eine üppige Version des von den Nazis einst diffamierten poetischen Märchen-Singspiels Premiere von Walter Braunfels' Oper "Die Vögel" am Grand Théâtre in Genf: Der Regisseur Yannis Kokkos entwirft eine üppige Version des von den Nazis einst diffamierten poetischen Märchen-Singspiels. Genf - Im Grand Théâtre der kalvinistischen Hochburg Genf baut Regisseur, Bühnen-und Kostümbildner Yannis Kokkos ein geometrisch abstrahierendes Wolkenkuckucksheim, in dem Die Vögel von Walter Braunfels (1882-1954) lustvoll zwitschernd Aug und Ohr verlocken. Die 1920 in München unter dem Dirigat von Bruno Walter uraufgeführte und bis 1933 höchst erfolgreiche Oper Die Vögel von Braunfels wurde von den Nazis als "entartete Musik" diffamiert und geriet bis 1971 in Vergessenheit. An der Wiener Volksoper wurde sie 1999 aufgeführt. Es war die Einstandsproduktion der Ära Dominique Mentha. Für den französischen Sprachraum hat nun der Intendant des Genfer Opernhauses, Jean-Marie Blanchard, das aufwändige Werk unter der musikalischen Leitung von Ulf Schirmer erstmals auf den Spielplan gesetzt. Braunfels "librettierte" selbst sein "lyrisch-fantastisches Spiel in zwei Akten" - frei nach Die Vögel von Aristophanes. Im zweiten Akt verlässt er jedoch die satirische Parabelvorlage zugunsten einer christlichen Fabelwendung, wo die von zwei Menschen (dem Demagogen Ratefreund und seinem romantischen Freund Hoffegut) zur Revolution gegen Zeus aufgehetzten Vögel vom allmächtigen Gott durch ein sintflutartiges Gewitter bestraft werden. Sich einnisten Ratefreund (Duccio Dalmonte), des Erdendaseins genauso überdrüssig wie der nach idealistischer Vereinigung mit der Natur strebende Hoffegut (Pär Lindskog), verlässt mit seinem Freund die Menschenwelt, um sich bei den Vögeln einzunisten. Die Nachtigall (die fehlerfrei intonierende, über der Bühne schwebende Marlis Petersen) begrüßt die beiden Aussteiger im Vogelreich. Ihr Liebesduett mit Hoffegut zu Beginn des zweiten Aktes ist stimmlicher und musikalischer Höhepunkt des poetischen Märchen-Singspiels. Ratefreund überredet den König der Vögel, Wiedhopf, zum Bau der utopischen Stadt Wolkenkuckucksheim, welche die Herrschaft der Vögel über die Menschen und die Götter etablieren soll. Prometheus (Roman Trekel) warnt die Vögel vergeblich vor Zeus. Im Gegensatz zum (von Bob Wilson beeinflussten) Bühnenbild zeichnete Yannis Kokkos fantasievolle Kostüme für die Vogelwelt. Er spielt mit dem Prinzip des Fracks, dessen Ärmel zu Flügeln werden. Bauchige Brustkörbe mit bunten Westen bringen Farbflecken auf die Bühne, die durch 60 verschiedene Vogelköpfe (die Solisten und Choristen) ergänzt werden. Wiedhopf stelzt wie ein Marquis des 18. Jahrhunderts über die Bühne, umgeben von einer heiteren Vogelschar, die aus dem Schnürboden herunterschwebt oder hüpfend von allen Seiten auftritt. Visueller Kontrapunkt neben den Menschen in Wanderkleidung ist der Prometheus: ein Marionetten-Riese. Ein Gott in Lehmfarben, von Menschenhand erschaffen und vom Schnürboden aus manipuliert. Ein guter Regieeinfall, der sich als musikalischer Reinfall entpuppt, da der Sänger anfangs nicht sichtbar, was leider heißt: auch nicht hörbar ist. Werkimmanenter Haken ist die Taubenhochzeits-Pantomime im zweiten Akt, die nach dem Liebesduett zwischen Nachtigall und Hoffegut als Zwischenspiel szenisch abfällt. Kokkos bemüht all seine Fantasie und viele Kunstgeschichtszitate. Wenn dann auch noch der Monologgesang des Prometheus erklingt, wünscht man sich eine aufregendere Lösung vor dem Ende mit Schrecken - das musikalisch versöhnlich ausfällt. Wie überhaupt das Orchestre de la Suisse Romande unter Ulf Schirmer den romantischen Aspekt der Oper privilegiert. Die Vögel ist - mit Parsifal - die aufwändigste der jährlich acht Produktionen des Genfer Grand Théâtre, das mit einem Budget von 49 Mio. Schweizer Franken (davon 33 Mio. Subvention und Hilfe der 400.000-Einwohner-Stadt Genf plus Mäzenatentum) die kostenintensivste kulturelle Einrichtung der französischen Schweiz darstellt. |
|
OPERA / «Gli uccelli» di Braunfels da Aristofane, ma con romanticismo Onore e merito al Grand Théâtre ginevrino, che crede in un titolo non raro ma rarissimo di Walter Braunfels (1882-1954) e investe su di esso le risorse riservate agli spettacoli di punta. E' Die Vogel (Gli uccelli) l' opera che il musicista di Francoforte sul Meno (della lunga schiera d' artisti vittime delle leggi razziali, si rifugiò proprio in Svizzera) scrisse nel ' 20 a Monaco, dove la tenne a battesimo Bruno Walter. Da allora, l' oblio, salvo un' edizione del teatro di Karlsruhe e una benemerita incisione del 1996. Eppure i valori che esprime sono alti. E non solo per l' esemplare qualità artigianale del tardoromanticismo di Braunfels. Ispirata ad Aristofane, l' opera ne esalta i tratti eminentemente lirici, coniugandoli con una sorta di ambientalismo utopico/fantastico che non ha nulla di politico ma molto di poetico. La scrittura corale è massiccia. E struggente, schubertiano, il dialogo notturno di Benespoir (il più mite dei fratelli protagonisti) e di un usignolo, magnificamente interpretato dal soprano di coloratura Marlis Petersen. Bene le voci di Duccio Dalmonte e Pär Lindskog. Solida, seppur priva di colpi di genio, la direzione di Ulf Schirmer, mentre qualche dubbio suscita la regia fantasiosa ma naturalistica di Yannis Kokkos. Enrico Girardi |
|
Aristofane secondo Braunfels Messa al bando nella Germania degli anni '30 a causa dell'atteggiamento antinazista del compositore, l'opera "Die Voegel'" (Gli uccelli) di Walter Braunfels, tratta dalla commedia omonima di Aristofane ed eseguita con successo per la prima volta a Monaco di Baviera nel 1920, non è riuscita più a reinserirsi nel repertorio corrente. Certo, in alcuni momenti l'azione dell'opera sembra languire in un preziosismo sonoro che richiama lo Strauss di "Arianna a Nasso" e de "La donna senz'ombra". Non pochi però sono però i momenti riusciti di questo lavoro dallo stile musicalmente 'aereo', che il talento visivo di Yannis Kokkos è riuscito a tradurre in quadri di grande suggestione. Facendo soprattutto leva sui suoi splendidi costumi ornitomorfi e sui complessi effetti luminosi di Patrice Trottier, il regista ha dato vita ad alcuni momenti memorabili, come l'entrata di Prometeo sotto forma di gigantesco burattino e la tempesta finale. Che Kokkos sia più scenografo e costumista che regista di 'attori' lo si vede però dalla direzione scenica dei cantanti, un po' lasciati a sé stessi nei dialoghi e a briglia sciolta nelle caotiche scene di massa, dove spesso non si capisce in che cosa consista il contributo coreografico di Richild Springer. Di buon livello ma un po' anonima la direzione di Ulf Schirmer, che comunque ha avuto a sua disposizione un cast di tutto rispetto. La breve apparizione di Prometeo è stata sicuramente il momento vocalmente più coinvolgente della serata: Roman Trekel è riuscito a delineare il suo personaggio in tutta la sua tragicità grazie ad un fraseggio di grande finezza drammatica. Impeccabile per sicurezza tecnica e grazia scenica si è rivelato il soprano Marlis Petersen nell'impervia parte dell'Usignolo, mentre a volte un po' in difficoltà con l'ampio registro di Hoffegut si è mostrato l'altrimenti bravo Pär Lindskog. Scenicamente godibili sono stati l'Upupa di Brett Polegato e il Ratefreund di Duccio Dalmonte. Il pubblico ginevrino, affascinato da questa 'riscoperta', ha tributato calorosi applausi agli interpreti e al regista. Michele Calella |
|
Die Vogel, Grand Théâtre, Geneva By Roderic Dunnett You know when a rare opera's a hit by the interval buzz. The excitement surrounding Walter Braunfels's Die Vögel (The Birds) in its heart-warming new staging by Geneva's Grand Théâtre was almost tangible. This exquisitely costumed, sympathetic production by Yannis Kokkos was entrancing. You need a cuckoo production to direct all the swallows and peewits, sedge warblers and red-necked grebes, toucans, ostriches and pink flamingos who, egged on by two unlikely earthlings, gang up against Zeus in Aristophanes' comedy of 414BC. But while his Birds is a merciless mockery of political pretension and human foible, Braunfels, writing in the wake of the Great War, turns it into an escapist's yearning for spiritual and erotic fulfilment, summed up in the scene between Hoffegut (Euelpides - Hopewell, or Optimist) and the Nightingale (the wonderful trapeze-borne Marlis Petersen), whose perfect flute-like trills provide much of the enchantment of this beautiful, dawn-chorus-filled score (premiered in Munich in 1920). Set against Kokkos's geometric cut-outs - an imaginative Neverland landscaped by Patrice Trottier's lighting and Eric Duranteau's startling video imaging (darkling skies explode in a terrifying climax at the stormy dénouement) - these warblers exceed all expectations. Especially good are the Canadian baritone Brett Polegato's shy, feather-crested Hoopoe and Kenneth Cox's resonant, supercilious Eagle. Every woodpecker wobble and jay's jostle, choreographed by Kokkos and the movement director Richild Springer, was laved in subtle avian emotions. The first chorus entries - from everywhere - were sheer magic, and the Act II choral climax was stupendous. One visual coup was Kokkos's spectacular handling of Prometheus's problematic entry (the birds having walled off heaven, the glowering demigod warns them of Zeus's mounting wrath). He descends, a giant two-thirds the height of the stage, and booms his vulture-pecked sorrows above the mêlée, before the Deutsche Staatsoper's Roman Trekel emerges to deliver, marvellously, his admonition. Pär Lindskog's agreeable Hoffegut, a warm, René Kollo-ish Heldentenor, suffered from momentary flattening latterly. But Duccio Dalmonte made a bluff, characterful Gutefreund (Peithetairos/Good Friend) and Regina Klepper an enjoyably fussy Wren. The conductor Ulf Schirmer revealed neo-Romantic credentials to rival Lothar Zagrosek, prising fabulous sounds from L'Orchestre de la Suisse Romande in this tingling, numbingly beautiful score. |
|
Opera: Die Vögel By Francis Carlin Die Vögel ("The Birds") illustrates the crassly undiscriminating sweep of the Nazi ban on entartete Musik. The real reason for cataloguing Walter Braunfels's music this way and stripping the composer of his post was because he was half-Jewish, though a convert to Catholicism. Degenerate? Braunfels's writing hardly fits the label, unless you consider his rich tapestry of post-Wagnerian orchestration as diseased - a tricky thesis for National Socialists. There is much in Braunfels's 1920 opera that recalls Die Meistersinger, particularly the assembly of the birds at the end of the first act, but the real debt to Wagner is in the clarity of the orchestration, performed here with admirable grace and tact by the Suisse Romande orchestra under Ulf Schirmer. Like Wagner, Braunfels produced enhanced chamber music, a far cry from Richard Strauss's overloaded approach, though he shares his contemporary's taste for sumptuous vocal writing and the coloratura Nightingale inevitably echoes Zerbinetta's fireworks. Equally, the Nightingale can be seen as a throwback to The Golden Cockerel and there is a distinct flavour of Rimsky-Korsakov's flair for Colour in the ravishing love duet. And yet all these influences are somehow subsumed into a style that is Braunfels's own. One-man-show Yannis Kokkos - production, sets and costumes - sensibly stages this philosophical fable, based on Aristophanes, with respectful detachment. A young Turk director would have hammered home the humanistic message and destroyed the delicate balance. Kokkos's striking vistas, beautiful projections and witty costumes avoid jarring notes, providing a sublime backdrop for a simple tale of manipulation and human vanity. Like Pär Lindskog's Good Hope - strong tenor tone though his intonation needs tightening - we leave the theatre wiser for the experience. Duccio Dalmonte's Loyal Friend overcomes initial woodenness and gets into his stride for the second act, Brett Polegato's Hoopoe is exquisitely phrased and Roman Trekel as the diminished Prometheus is fiercely dramatic in his outburst. The clapometer rightly explodes for Marlis Petersen's sensational Nightingale which has it all: accuracy, warmth and buckets of charm. If this enchanting production doesn't help reinstate a work of such emotive power, then nothing will. |